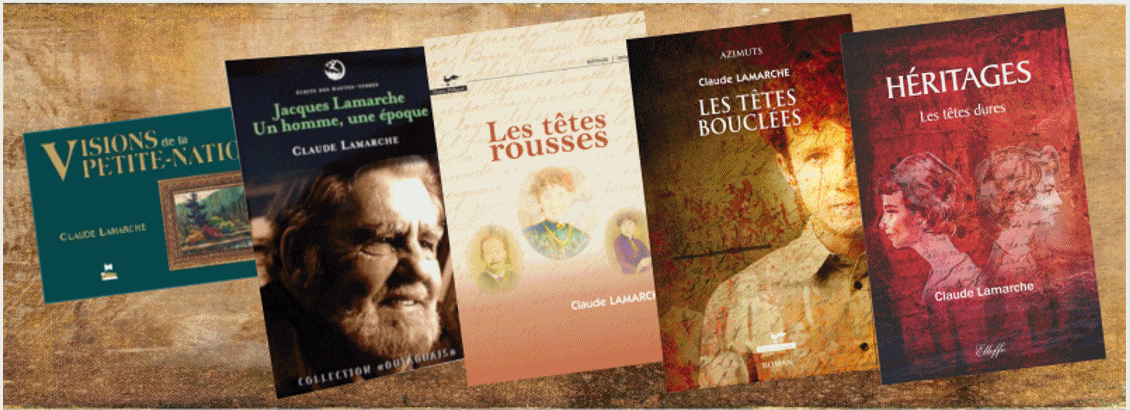La Petite-Nation? Où est-ce? En Outaouais. Ni région administrative, ni région touristique officielle, ni MRC (même si c’était le premier nom qui ne fut pas retenu pour la MRC Papineau), une région du cœur. Son nom prend naissance dans la seigneurie de la Petite-Nation.
 |
| Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir |
Voilà pour la situation géographique. Les Deguire maintenant puisque le sujet de cette série de billets porte sur les descendants de François Deguire dit Larose.
Le jour où j'ai choisi de m'installer dans la Petite-Nation, en 1970, après l'avoir connue en tant que touriste estival depuis 1956, j'ai entendu le patronyme Lamarche ici et là, sans plus. Au moins un Bricault, le coloré curé que nous connaissions bien depuis 1956, au temps où nous allions encore à la messe du dimanche, l’été, à Montpellier. Il fut transféré à Notre-Dame-de-la-Paix par la suite. Mais de Deguire, point. Je croyais naïvement ma mère toute seule à être Deguire dans cette région outaouaise.
L’enseignement nous permet de rencontrer rapidement de nombreuses familles. Alors des Larose, oui, j’en ai connu plusieurs. Dont le très dynamique chauffeur d’autobus, Zéphirien Larose. Je n’étais pas certaine qu’ils fussent tous des descendants de François Deguire dit Larose, mais quand j’ai commencé à m’intéresser à la généalogie, à poser des questions, à avoir accès aux dictionnaires et aux registres, je fus surprise de trouver autant de personnes issues du même ancêtre que ma mère. Dans les registres paroissiaux, tous Larose ou Deguire confondus, c’est à Ripon que j’en ai dénombré près d’une centaine.
Mes deux questions :
Quand ont-ils délaissé le Deguire pour le Larose? Après 1900 on dirait bien. Dans les registres, pendant longtemps les deux noms, alors que même mon arrière-grand-père, à Saint-Laurent, n’a jamais employé le patronyme Larose. Quant à savoir pourquoi, j’ai eu vent que c’était souvent une simple chicane de famille, mais tous? Quand on se chicane, certains sont d’un côté et les autres d’un autre, tandis que là…. que des Larose. Les rares Deguire sont plutôt plus à l'ouest du côté de Gatineau, Masson, Ange-Gardien, Lochaber.
Ensuite: comment sont-ils arrivés dans la Petite-Nation. J’ai répondu en partie à cette seconde question en regardant le lieu des mariages : départ de Saint-Ours en 1700, puis Boucherville, quelques générations à Saint-Laurent entre 1750 et 1800, de terre en terre, de paroisse en paroisse vers Saint-Benoît ou Saint-Hermas ou Saint-Scholastique et arrivée à Saint-André-Avellin ou Chénéville un peu avant 1870. Il me reste à savoir quelles familles se sont dirigées vers la Petite-Nation, seulement celle de Jean-Baptiste Deguire et Appoline Cyr? Au moins une autre famille, celle du fils de Pierre Deguire et de Marie-Joseph-Françoise Groux et j'en parlerai dans un prochain billet : Le jour où… j’ai appris l’histoire de Canard-Blanc.
La nouvelle page Facebook s'enrichit chaque jour >>>
(Illustration empruntée au site Mémoire du Québec >>>)
La nouvelle page Facebook s'enrichit chaque jour >>>
(Illustration empruntée au site Mémoire du Québec >>>)