Dans l’ordre : premier plaisir, le camping
Deuxième : le vélo
Troisième : la lecture
Deuxième : le vélo
Troisième : la lecture

Le camping : je me suis réconciliée avec les Sepaq. Je les boudais parce que je trouvais prohibitifs leurs coûts d’entrée : 7,50 $ par jour par personne. En prenant une passe pour le réseau : 135 $ pour deux, j’ai accès à tous les parcs, sans avoir à me soucier de ces frais d’accès. En les oubliant, j’ai l’impression de ne pas les payer. Reste le camping. Le sans service est de 29 $ la nuitée et le deux services de 38,25 $ Plus les taxes. Disons que c’est un prix assez compétitif si on ne compare pas les genres de campings. Dans les Sepaq, ce ne sont pas les services, le wi-fi ou les activités qu’on va chercher, mais surtout l’espace et la nature. La nature et encore la nature. Alors au parc Yamaska, je fus servie, gâtée. J’ai beaucoup aimé.
Le vélo : des pistes cyclables, des vraies, pas des bandes cyclables le long d’une route. Le rêve pour une promeneuse comme moi. Je ne cherche plus ces sentiers de vélo de montagne escarpées où il faut grimper, descendre debout sur les pédales. Je préfère le plat, le facile. Autour de Granby, je suis servie. Une région où je n’allais plus puisqu’il fallait passer par Montréal, Décarie et pont Champlain. Avec l’ouverture d’un tronçon de l’autoroute 30 du barrage de Beauharnois, je peux me rendre dans les Cantons de l’Est dans un petit deux heures. Des points de vue le long du réservoir Choinière, des haltes le long de rivière Yamaska Nord. Du soleil, des gens gentils. Rien que du présent.
La lecture: ça faisait longtemps que je n’avais pas lu. Longtemps, dans mon cas, c’est près de trois semaines. Faisait encore plus longtemps que je n’avais pas lu un livre:
1- écrit par une femme
2- écrit par une auteure de ma génération (nous avons dix mois de différence)
3- écrit par une Québécoise
Et ce n’est pas tout, elle a écrit sur la mort de sa mère survenue en décembre 2011, or la mienne est décédée en mai 2012. Pire encore, tout comme dans ma famille, elle a une tante qui a séjourné à Saint-Jean-de-Dieu de Montréal et à Saint-Michel-Archange de Québec.
Donc, identification, sentiment de sororité. J’ai lu avec grand intérêt.
Heureusement, je n’avais pas Internet, je me serais ruée sur ma tablette pour tout savoir de cette auteure et peut-être même lui écrire. Ce que je ferai peut-être. Pour lui dire merci. Merci d’avoir écrit sur la relation mère-fille, sur la mort, sur celle des autres, sur la nôtre qui viendra trop vite.
À la mort de mon père, je n’ai pas senti le besoin d’écrire sur lui. Dans les faits, j’ai écrit sa biographie avant qu’il ferme les yeux pour toujours, un certain soir du mois d’août 2006. J’étais plus fille de mon père que fille de ma mère, je dirais. Ce sont pourtant des images de ma mère qui resurgissent parfois. Je revois les derniers jours quand je lui tenais la main. Je cherche encore ce qu’elle voulait me dire en ouvrant la bouche et en murmurant trois « mouah» en me regardant. Je ne saurai jamais. Il me vient des émotions dans un geste de ses petits-enfants. Je me dis qu’elle aurait aimé, souri.
Louise Dupré dans L’album multicolore a tout de même écrit 191 pages sur ce sujet. Je la remercie d’avoir tant écrit, sans trop de répétitions, à part sa «mauvaise lumière du salon», qui à la fin me faisait sourire.
Je lui envie son éditeur qui a accepté de publier un tel récit. Je me demande s’il lui a suggéré d’enlever quelques « mauvaise lumière du salon ». Bien sûr, j’ai noté plusieurs phrases dont celle-ci : « mais, même sans larmes, l’enfance reste tapie dans un coin sombre, elle nous guette, elle ne meurt jamais ». Je ne fus pas surprise d’y voir une phrase que je glisserai dans mon prochain roman. J’aurai l’air d’avoir copié, mais la mienne a été écrite en 2006 : « on ne sort pas indemne de son enfance ».
En voyant sa bibliographie et les nombreux prix remportés, je me réjouis pour elle de sa réussite. Je ne suis pas très poésie, mais je lirai certainement ses romans.
La lecture: ça faisait longtemps que je n’avais pas lu. Longtemps, dans mon cas, c’est près de trois semaines. Faisait encore plus longtemps que je n’avais pas lu un livre:
1- écrit par une femme
2- écrit par une auteure de ma génération (nous avons dix mois de différence)
3- écrit par une Québécoise
Et ce n’est pas tout, elle a écrit sur la mort de sa mère survenue en décembre 2011, or la mienne est décédée en mai 2012. Pire encore, tout comme dans ma famille, elle a une tante qui a séjourné à Saint-Jean-de-Dieu de Montréal et à Saint-Michel-Archange de Québec.
Donc, identification, sentiment de sororité. J’ai lu avec grand intérêt.
Heureusement, je n’avais pas Internet, je me serais ruée sur ma tablette pour tout savoir de cette auteure et peut-être même lui écrire. Ce que je ferai peut-être. Pour lui dire merci. Merci d’avoir écrit sur la relation mère-fille, sur la mort, sur celle des autres, sur la nôtre qui viendra trop vite.
À la mort de mon père, je n’ai pas senti le besoin d’écrire sur lui. Dans les faits, j’ai écrit sa biographie avant qu’il ferme les yeux pour toujours, un certain soir du mois d’août 2006. J’étais plus fille de mon père que fille de ma mère, je dirais. Ce sont pourtant des images de ma mère qui resurgissent parfois. Je revois les derniers jours quand je lui tenais la main. Je cherche encore ce qu’elle voulait me dire en ouvrant la bouche et en murmurant trois « mouah» en me regardant. Je ne saurai jamais. Il me vient des émotions dans un geste de ses petits-enfants. Je me dis qu’elle aurait aimé, souri.
Louise Dupré dans L’album multicolore a tout de même écrit 191 pages sur ce sujet. Je la remercie d’avoir tant écrit, sans trop de répétitions, à part sa «mauvaise lumière du salon», qui à la fin me faisait sourire.
Je lui envie son éditeur qui a accepté de publier un tel récit. Je me demande s’il lui a suggéré d’enlever quelques « mauvaise lumière du salon ». Bien sûr, j’ai noté plusieurs phrases dont celle-ci : « mais, même sans larmes, l’enfance reste tapie dans un coin sombre, elle nous guette, elle ne meurt jamais ». Je ne fus pas surprise d’y voir une phrase que je glisserai dans mon prochain roman. J’aurai l’air d’avoir copié, mais la mienne a été écrite en 2006 : « on ne sort pas indemne de son enfance ».
En voyant sa bibliographie et les nombreux prix remportés, je me réjouis pour elle de sa réussite. Je ne suis pas très poésie, mais je lirai certainement ses romans.
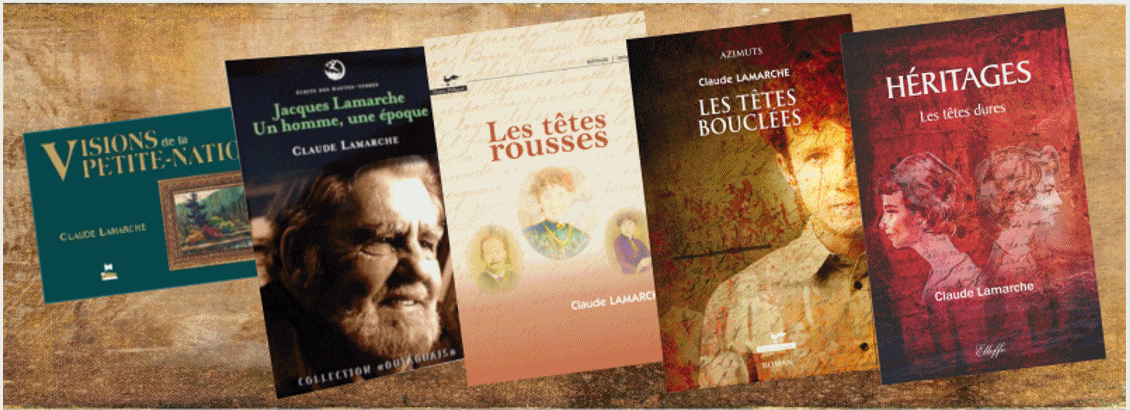








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
+(467x700).jpg)


